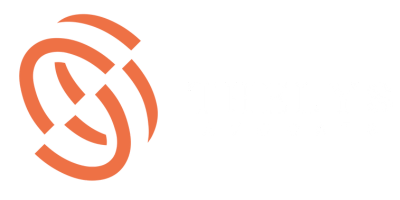L’assistance et les conseils d’un avocat sont incontournables lors de la négociation d’une transaction à la suite d’une rupture de contrat de travail. Cette transaction, régie par l’article 2044 du Code Civil, met fin à un litige ou l’évite.
À quel moment faire une transaction ?
Elle doit être conclue après la rupture définitive du contrat, donc après que le salarié ait reçu sa lettre de licenciement en recommandé. Il faut en effet que le salarié ait une parfaite connaissance des motifs au soutien de son licenciement.
Quel est le contenu de la transaction ?
La transaction résout les conflits liés à la rupture du contrat. Il est donc exigé des concessions réciproques entre les parties. Le salarié renonce généralement à des poursuites en échange d’une indemnité. Attention, des concessions authentiques, réelles et non-dérisoires sont essentielles pour éviter l’annulation de la transaction.
Quelles conditions de forme pour une transaction ?
En principe, aucune condition de forme n’est imposée, mais une formalisation écrite est fortement recommandée pour des raisons évidentes de preuve. Cette transaction doit ainsi être établie en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.
Quelle est la portée de la transaction ?
La transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties, contrairement à la rupture conventionnelle. Elle évite ainsi les litiges futurs, mais peut être contestée en cas d’inexécution ou annulée si les conditions de validité ne sont pas remplies.